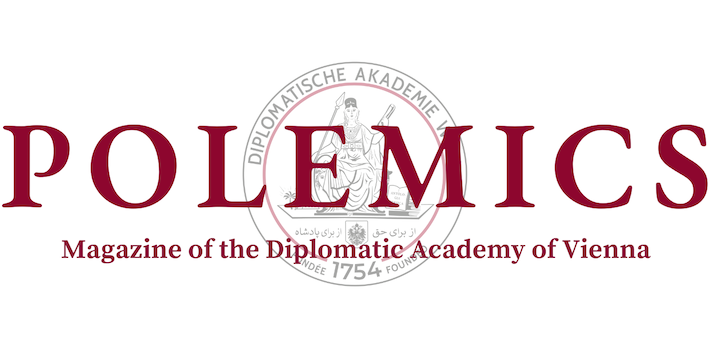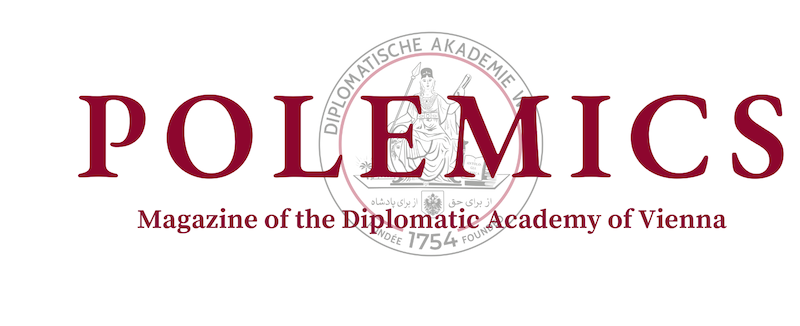La violence conjugale : une pandémie fantôme
Depuis le début de la pandémie, la chaîne de télévision franco-allemande « Arte » diffuse un journal mondial de la pandémie intitulé « Viral ». Sa 27e édition était consacrée à un sujet brûlant, comme le révèlent son titre et son sous-titre : « Violences Conjugales : La Pandémie Fantôme ». Une preuve de plus que cette pandémie touche surtout les femmes. Ce sont les femmes qui en font majoritairement les frais, dans l’anonymat de leurs maisons. Le confinement précipité par la pandémie cache donc d’autres pandémies « fantômes », notamment les violences conjugales. Le but de cet article est de dévoiler les tendances inquiétantes revêtues par ce phénomène à travers le monde en ces temps de confinement.
D’après la plateforme du gouvernement français « arretonslesviolences.gouv.fr », il y aurait eu cinq fois plus de signalements de violences conjugales durant le confinement en France. La ministre responsable a notamment observé « environ 35% de plus de signalements aux forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales ».
Il faut absolument se poser la question de pourquoi ce phénomène de croissance des violences se vérifie aujourd’hui, et du type de violence auquel les femmes sont confrontées durant ces temps de confinement. Les rues sont désertes, les transports peu fréquentés, l’espace public vide. Avec moins de personnes dans les rues, il y a moins de personnes à agresser. Mais il y a aussi moins de témoins :
« Les sorties se transforment en des moments d’angoisse ».
« La journée devient la nuit, il n’y a plus de différence pour les femmes ».
« Je ne pouvais me réfugier nulle part, tous les magasins étaient fermés et je pouvais demander de l’aide à personne ».
Les femmes victimes de violences conjugales sont sujettes à un sentiment envahissant d’insécurité, que ce soit par le biais de harcèlement (de rue), d’agressions sexistes et sexuelles, ou, dans les configurations les plus extrêmes, de viol. Des expériences désagréables et, dans bien des cas, durablement dégradantes.
Dans la banlieue parisienne de Val-de-Marne, il était impossible, pendant plusieurs semaines, d’échapper à la violence du fait du confinement. Aller faire ses courses au supermarché, seul motif de déplacement valable aux yeux des autorités, a représenté pendant de nombreux jours la seule issue envisageable pour demander de l’aide à quelqu’un pour les femmes en détresse. En réponse à ce phénomène restrictif nouveau, la chaîne de supermarchés française Carrefour a pris l’habitude d’insérer automatiquement un numéro d’urgence, le 3919, sur ses tickets de caisse, et d’installer des points d’accompagnement éphémères sur ses sites pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales. D’autres enseignes de la grande distribution comme Leclerc sont allées jusqu’à faire figurer ce même numéro d’urgence sur l’emballage de leurs produits, notamment des pizzas surgelées.
Début avril, l’ONU rappelait qu’au cours des 12 derniers mois, 243 millions de femmes et de filles avaient été victimes de violences physiques ou sexuelles à travers le monde. Cette réalité malheureuse se retranscrit, du moins lorsque cela est permis, en une augmentation de la fréquentation des centres d’accueil et en une saturation des lignes d’assistance téléphonique mises à disposition des victimes. La partie qui suit se propose de mettre en lumière la configuration de cette « pandémie fantôme » dans plusieurs pays du monde.
Au Mexique, on a pu constater une hausse des violences conjugales à l’encontre des femmes à mesure que la durée du confinement s’étendait. L’initiative citoyenne locale « ¡Ni una más! » s’évertue à attirer l’attention sur le fait que, actuellement, dix femmes sont assassinées chaque jour dans le pays. Depuis le début du confinement décrété par le gouvernement, les appels aux numéros d’urgence pour les victimes de violences conjugales ont notamment augmenté de 60% ! Si le fait de rester chez soi est synonyme, pour la plupart d’entre nous, de calme et de sécurité, la réalité est bien souvent différente au Mexique… Il s’agit donc de briser ce cycle de violences.
La Russie, d’après les statistiques, compte environ 16 millions de victimes de violences conjugales par an. Cependant, seulement 10% de ces victimes se résolvent à accuser leur agresseur, prisonnières de coutumes résumées par l’adage fautivement complaisant « s’il te bat, c’est qu’il t’aime ». Aujourd’hui, alors que leur action est plus nécessaire que jamais, les centres d’accueil pour les femmes du pays ont vu leur portée diminuer, du fait de règles très strictes de confinement adoptées par le gouvernement. C’est pourquoi, certaines ONG font désormais appel aux hôtels désertés pour accueillir des victimes de violences conjugales. Parmi les femmes accueillies, certaines allaient jusqu’à porter la marque de traumatismes crâniens aigus. En 2017, la Russie a adopté une loi de décriminalisation des violences conjugales, faisant encourir aux hommes jugés coupables une simple amende…
En Algérie, la période du ramadan, qui s’est conjuguée au confinement, a rendu les cas de violences particulièrement difficiles pour les femmes concernées. Bien souvent, celles-ci portent toute la responsabilité. Tout « non » peut être puni. Ces femmes, qui se rencontrent et s’organisent ensemble, sont perçues comme un danger pour les hommes. Aujourd’hui, on y parle de plus en plus de « féminicide » : tuer une femme parce qu’elle est une femme. Ce terme est bien écrit dans la législation algérienne.
En Côte d’Ivoire, le centre « femmes en action » a été créé dans le quartier Abobo à Abidjan. Celui-ci reçoit des femmes victimes de violences conjugales, leur fournissant une écoute et des conseils et se proposant de parler directement aux hommes concernés pour résoudre d’éventuels problèmes familiaux ayant fait le lit de ces violences. Leur tâche n’est pas maigre puisque, bien souvent, on y ressasse que « frapper une femme, c’est normal ». Ce survol de la condition des femmes durant le confinement montre qu’il reste encore énormément à faire. Familiariser le grand public avec ce problème amplement diffus serait, certes, un premier pas modeste, mais certainement un point de départ pour commencer à changer les choses.
Edited by Nicola Manfredi Audibert
Picture taken by Pete Linforth from Pixabay.com